Parfois, ce sont de petites choses qui vous font remonter à une phrase, une intrigue. Là, ce sont des pavés en bois. Oui, des pavés de rue, mais en bois, comme sur la photo que j’ai prise. Ici, le parfum d’une boulangerie et la couleur dorée de bretzels couverts de sésame. C’est une boutique de tailleur, un déferlement de soies vives dans une vitrine, les arabesques au fond d’un atelier de lutherie. C’est un nom, comme celui de la très ancienne église de Colţea ou tout simplement l’imagination, quand le coeur vous entraîne et que la ritournelle de la « cité des coeurs légers » ne vous lâche plus. La « cité  des coeurs légers », sous la plume de Doïna Ruşti, c’est Bucarest fin 18e, la ville de Bucur le joyeux. On y crée des parfums, on y danse. La réputation de ville des plaisirs et du luxe arrive aux oreilles de Ioanis Milikopu, qui vit encore chez ses parents à Salonique. Le jeune garçon, qui veut coudre les plus beaux tissus du monde entame alors un voyage hasardeux jusqu’à Bucarest…
des coeurs légers », sous la plume de Doïna Ruşti, c’est Bucarest fin 18e, la ville de Bucur le joyeux. On y crée des parfums, on y danse. La réputation de ville des plaisirs et du luxe arrive aux oreilles de Ioanis Milikopu, qui vit encore chez ses parents à Salonique. Le jeune garçon, qui veut coudre les plus beaux tissus du monde entame alors un voyage hasardeux jusqu’à Bucarest…
Je marche dans Bucarest et les phrases du Manuscrit phanariote m’accompagnent. Je vous livre un secret? Je pense que ce roman sera une de mes prochaines traductions, quand j’aurai fini
le livre de Savatie Bastovoi sur lequel je travaille en ce moment.
Le début du livre sonne comme ça (à vous de me dire si cela vous donne envie de connaître la suite) :
Prologue
« Il ne faut pas chercher le commencement d’un livre à sa première page. Le Manuscrit phanariote ne fait pas exception. Notre histoire a germé dans la bibliothèque du Sérail. C’est là que le sultan Selim découvrit un jour deux pages d’une partition rédigée d’une main nerveuse, qui donnait au dessin de chaque note de musique l’aspect de pattes de mouches noyées dans le café.
Selim déchiffra la mélodie à voix haute. C’était quelque chose de gai. Un tourbillon effréné de quelques notes qui se déployaient en se répétant et on sentait combien d’âmes s’étaient confiées dans ce chant. Il palpa le papier en se désintéressant de la signature minuscule. La même main avait rédigé les paroles, juste sous les notes, dans une langue savante qui rappelait à Selim les leçons de son premier précepteur, qui était tout rond, comme une perle. Ces trois strophes célébraient une cité de tous les bonheurs.
La chanson lui rentra dans la tête et la journée n’était pas finie que tout le palais la connaissait déjà ; elle se répandit dans les rues et dans les tavernes – parce qu’elle sortait de la bouche du grand Selim, bien évidemment, mais aussi parce qu’elle était entraînante et qu’elle vo us faisait battre le cœur plus vite. Les paroles évoquaient une ville qui exhalait le tilleul. Entre ses murs, toute souffrance s’évanouissait, elle était comme effacée du Livre de la Destinée – ou de ses innombrables copies.
us faisait battre le cœur plus vite. Les paroles évoquaient une ville qui exhalait le tilleul. Entre ses murs, toute souffrance s’évanouissait, elle était comme effacée du Livre de la Destinée – ou de ses innombrables copies.
Cette cité des cœurs légers n’était autre que Bucarest.
Puis, des rumeurs commencèrent à circuler, alimentées par les Grecs du quartier du Phanar, des gens qui parlaient comme s’ils avaient un cheveu sur la langue. Ils étaient les seuls à connaître les contrées au-delà du Danube, là où se trouvait la ville de la chanson. Grâce à eux, on savait qu’en traversant le pont qui se trouvait à l’entrée de cette cité lointaine, tout visiteur perdait l’envie de revenir sur son propre passé. Dans les rues en pavés de chêne tournoyaient les vapeurs qui s’élevaient de récipients argentés où frémissaient en continu les élixirs, les parfums et les onguents : la ville ne vivait ni du travail de la terre, ni de ses nombreux commer ces, mais de ces fragrances toujours renouvelées, de ce souffle tiède qui vous envahissait tous les pores de la peau en vous effaçant la mémoire, si vous étiez nouveau venu. Alors vous n’aviez plus qu’une ambition, un seul destin, celui de devenir un émir aux yeux de saphir, un nabab menant grand équipage et recevant en son palais, ou alors un gouverneur, un colonel ou encore, et ce serait tout aussi merveilleux, un simple gratte-papier attaché à la suite princière…
ces, mais de ces fragrances toujours renouvelées, de ce souffle tiède qui vous envahissait tous les pores de la peau en vous effaçant la mémoire, si vous étiez nouveau venu. Alors vous n’aviez plus qu’une ambition, un seul destin, celui de devenir un émir aux yeux de saphir, un nabab menant grand équipage et recevant en son palais, ou alors un gouverneur, un colonel ou encore, et ce serait tout aussi merveilleux, un simple gratte-papier attaché à la suite princière…
D’autres personnes racontaient l’histoire d’hommes qui déambulaient dans les rues, désorientés, ivres d’amour, repus de toutes les bonnes choses auxquelles ils avaient rêvé ; ils étaient torturés par les désirs qui rongeaient la partie la plus fragile de leur chair mais ils forçaient leur corps à jouir des douleurs de cette passion et du poison d’un soupir.
Mais quelle que soit la nature de leurs changements de vie, tous tombaient dans l’euphorie. Aucun tourment, aucune tristesse ne résistaient à Bucarest, et c’était le sens même du nom de cette ville joyeuse, un nom qui tintinnabulait aussi gaiement que des clochettes de traîneaux dans les plaines enneigées.
Alors, les Grecs du Phanar exhumèrent tout l’or qu’ils avaient caché dans les caves et dans les fondations de leurs maisons pour convaincre le sultan de leur confier le trône de Bucarest – et ils se contenteraient de très courtes périodes, pourvu qu’ils l’obtiennent. La notoriété de Bucarest fit le tour de l’Empire Ottoman et plus personne n’ignorait que c’était la ville où les rêves se réalisaient. Dans les cafés d’Istanbul, le commerce de luxe se développa, car les commerçants les plus stylés cédaient leur marchandise au plus offrant, et les enchères s’envolaient sur le lévrier de Moldavie, l’épervier de Bucarest et les enfants valaques. »
Extrait de Le Manuscrit phanariote, Doïna Ruşti, éditions Polirom.



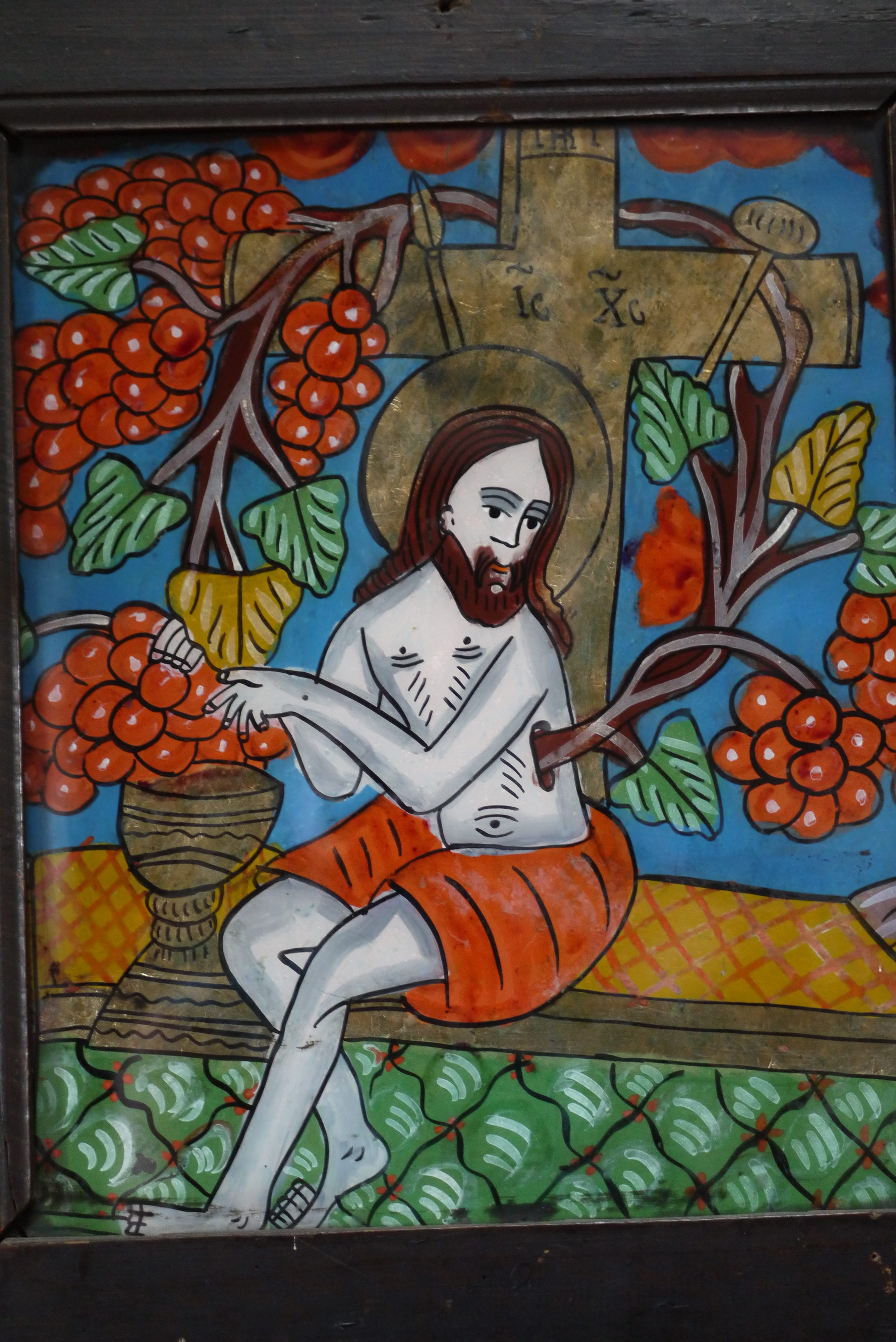



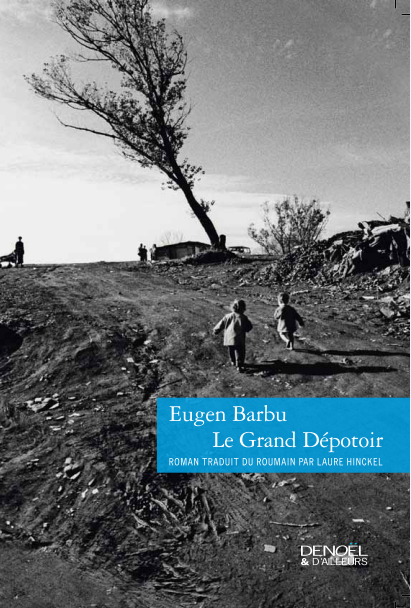



 Archavir Acterian se souvenait parfaitement des discussions de leurs vingt ans, des sorties en groupe qui se terminaient souvent dans la mansarde de Mircea Eliade, professeur de certains de leurs amis. Les clowneries d’Eugène Ionesco, les éclats de rire d’Emil Cioran brillaient encore dans ses yeux. Il déployait ainsi devant moi et pour moi l’immense scène du théâtre bucarestois des années 20 et 30. Archavir Actérian était prolixe, précis et d’une urbanité délicieuse. Il ébauchait en quelques mots le portrait des Emil Cioran, Mircea Eliade, Emil Botta, Petre Tutea, Mihail Sebastian et autres. Parmi tous ces garçons, il y avait aussi quelques filles. La sœur d’Archavir Actérian, Jeni, nous a laissé un journal magnifique.
Archavir Acterian se souvenait parfaitement des discussions de leurs vingt ans, des sorties en groupe qui se terminaient souvent dans la mansarde de Mircea Eliade, professeur de certains de leurs amis. Les clowneries d’Eugène Ionesco, les éclats de rire d’Emil Cioran brillaient encore dans ses yeux. Il déployait ainsi devant moi et pour moi l’immense scène du théâtre bucarestois des années 20 et 30. Archavir Actérian était prolixe, précis et d’une urbanité délicieuse. Il ébauchait en quelques mots le portrait des Emil Cioran, Mircea Eliade, Emil Botta, Petre Tutea, Mihail Sebastian et autres. Parmi tous ces garçons, il y avait aussi quelques filles. La sœur d’Archavir Actérian, Jeni, nous a laissé un journal magnifique.  Je l’ai à la main, alors que je passe devant ce fameux numéro 52. Quelle personnalité brillante ! Quels dialogues mémorables entre elle et Eugène Ionesco ! Je crois qu’ils étaient un peu amoureux. Surtout Eugène, dont personne n’offense la mémoire en racontant –comme me l’a raconté Archavir en ce jour du printemps 1994- qu’il avait à 20 ans un vrai cœur d’artichaut ! Toujours amoureux, toujours se languissant d’amour.
Je l’ai à la main, alors que je passe devant ce fameux numéro 52. Quelle personnalité brillante ! Quels dialogues mémorables entre elle et Eugène Ionesco ! Je crois qu’ils étaient un peu amoureux. Surtout Eugène, dont personne n’offense la mémoire en racontant –comme me l’a raconté Archavir en ce jour du printemps 1994- qu’il avait à 20 ans un vrai cœur d’artichaut ! Toujours amoureux, toujours se languissant d’amour. Letitia est le nom de l’héroïne. Elle est adolescente et elle étouffe, entre sa mère et son oncle. L’un et l’autre ploient à un moment ou à un autre sous la roue dentée de l’engrenage dictatorial. Letitia, elle, suffoque tout simplement. Et le lecteur la suit entre deux souffles.
Letitia est le nom de l’héroïne. Elle est adolescente et elle étouffe, entre sa mère et son oncle. L’un et l’autre ploient à un moment ou à un autre sous la roue dentée de l’engrenage dictatorial. Letitia, elle, suffoque tout simplement. Et le lecteur la suit entre deux souffles.